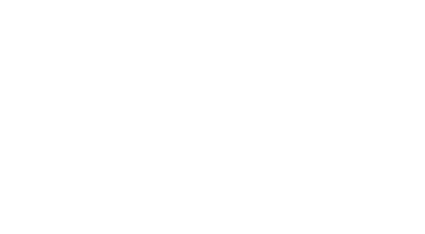La profession d’agent.e de chambre mortuaire
La médecine légale en France est divisée en deux secteurs d'activité : les unités Médico-Judiciaires (UMJ) où se déploie la médecine légale du vivant (examen des victimes, constatation des lésions ) et les instituts Médico-Légaux (IML). Ces derniers accueillent les actes thanatologiques (autopsies) dans une perspective d'enquête (identifier la cause du décès, identité du cadavre ). En sociologie, Romain Juston-Morival (2020) s'est intéressé aux médecins légistes des UMJ. En psychologie, Léa Boursier (2021, 2023) s'est penchée sur les légistes en IML. Il est une population, identifiée par les chercheurs mais qui n'a pas fait l'objet d'une attention spécifique : les agents de chambre mortuaire. Ceux-ci forment une population inattendue en sociologie des groupes professionnels : ayant un diplôme d'aide-soignant (un diplôme d'Etat obtenu après la validation d'une année de formation post bac dispensée en Institut de Formation des Professionnels de Santé), ils et elles assistent les légistes lors des autopsies. Ces derniers vont les considérer comme « leur bras droit » (Boursier, 2023) alors que les aides-soignants sont habituellement un personnel invisible à l'hôpital selon la formule d'A.M Arborio (2001). A côté des tâches qui leur sont habituellement dévolues et qui touchent à « la souillure » (Douglas, 2001), de la préparation des corps aux soins mortuaires en passant par un travail d'hygiène et d'entretien, en évacuant les bio-déchets ou en procédant au nettoyage des locaux par exemple, leur activité les engage dans des pratiques à l'intersection du travail relationnel lors de l'accueil et de l'accompagnement des familles de défunts mais aussi un travail médical en assistant les médecins légistes. La singularité du lieu d'exercice rend essentiel une analyse en termes de travail émotionnel (Hochschild, 2003) et des manières de résister à l'activité (Molinier, 2006). Peut-être faudra-t-il se rappeler que mourir n'est pas être mort (Baudry, 2004) et que seule la ritualité funéraire permet cette transformation. Cela inscrit le travail réalisé en IML dans un temps liminaire (Turner, 1990) où celui qui vient de mourir est encore présent à son corps. Cela expliquerait les multiples marques d'attention manifestées envers un cadavre qui n'est pas un objet : de la caresse des cheveux aux mots d'excuse quand les gestes techniques sont invasifs ou qu'ils ne sont pas bien réalisés, en passant par les questions ou les remarques qui lui sont adressées. Pour le dire à la manière de Marie-Christine Pouchelle (2003), il n'y a pas que des corps et de la technique à la morgue. On se demandera alors qui devient et comment devient-on agent.e de chambre mortuaire ? L'approche sera compréhensive, fondée sur un recueil de données qualitatif. Une quarantaine d'entretiens, semi directifs et approfondis, seront menés avec les agents mortuaires ainsi qu'avec les autres professionnels travaillant en IML (cadre de santé, médecin, thanatopracteur ). Si les entretiens permettent de saisir ce que les acteurs disent de ce qu'ils font, cette méthode gagne à être complétée par de l'observation in situ pour voir ce que réalisent les acteurs en activité. Ces observations permettront de saisir les interactions en acte lors des collaborations au travail, de voir le travail en train de se faire.
Sous la direction de Florent SCHEPENS.
Lien vers theses.fr : https://theses.fr/s397972
- Formation des professionnels / Pédagogie
- Histoire de la mort
- Parcours de soin
- Pratiques funéraires / Soins post-mortem
- Représentations sociales et culturelles
- Vécus et perceptions
- Chambre mortuaire
- Socio-anthropologie des groupes professionnels
- Aide-Soignant.es
- Socio-anthropologie des émotions
- MESR - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace
- Université Marie et Louis Pasteur
lilou.vouthier[at]edu.univ-fcomte.fr